L’ASAF propose une étude sur un phénomène peu exploré – qui est celui des choix personnels, de l’engagement au sein du ministère des Armées dans notre XXIème siècle; donc du volontariat . Et de son corolaire, le départ, la démission, désertion lorsque l’individu juge que l’objectif initial est inatteignable. Le vocabulaire parle d’engagement, de fidélisation de renouvellement, de désertion.
Dans un premier temps, Pascal Tran Huu résume les mesures bureaucratiques qui ont été prises avec célérité pour sinon enrayer, du moins contenir ou restreindre l’érosion des effectifs. Bien sûr ces mesures, bien ciblées, sont parfaitement adaptées aux évolutions de notre société et généreuses.
Seront-elles suffisantes pour éradiquer les fuites ? selon toute probabilité la réponse est négative. Car l’adhésion des convictions et des talents repose aujourd’hui comme dans l’Athènes de Périclès soit sur l’identification à une cause jugée juste, voire un sacerdoce, soit à un homme et chef charismatique.
Puis le phénomène de désertion est remis en perspective car il n’épargne pas les armées françaises aujourd’hui, au même titre que les autres armées occidentales.
Il faut remercier Pascal Tran Huu d’aider à ouvrir le débat du volontariat, des raisons qui favorisent l’épanouissement de la volonté de défense et des caractéristiques modernes de l’autorité et du charisme.
C’est la raison qui fait que les chefs de corps d’aujourd’hui sont jugés, en partie, sur leur capacités à attirer de nouveaux candidats au métier des armes, puis ensuite sur leur habilité à les maintenir dans leurs effectifs.
GCA Robert Meille
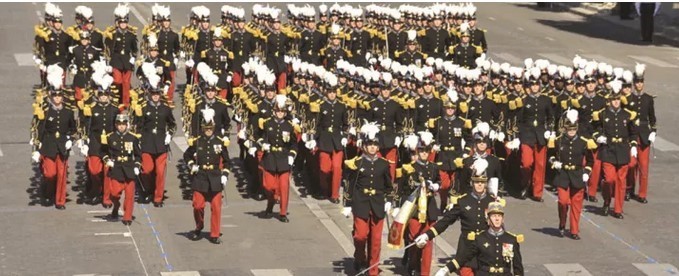 « Une armée, c’est une nation dans la nation. »
« Une armée, c’est une nation dans la nation. »
Charles de Gaulle, 1941
Derrière les effectifs et les bilans comptables, il y a des femmes et des hommes. Des engagés et des fidèles. Des départs aussi, trop nombreux. C’est tout l’enjeu du rapport d’information n° 1152, déposé à l’Assemblée nationale en mars 2025 par Caroline Colombier et Loïc Kervran : comprendre pourquoi les armées peinent à recruter, pourquoi elles n’arrivent plus à retenir un déficit de vocations et une fuite des talents.
L’année 2023 marque une rupture. Le recrutement fléchit, notamment chez les militaires du rang, pendant que les départs s’accélèrent. Les catégories B et C civiles sont les plus touchées. Pourquoi ? Parce que le service de l’État attire moins qu’autrefois. Parce que le secteur privé embauche, mieux et plus vite, dans les métiers-clés que sont le cyber, le spatial ou la maintenance aéronautique. Parce que les sujétions sont lourdes, et les compensations encore trop faibles.
Une réponse globale : le plan Fidélisation 360
Face à ce constat, le ministère des Armées déploie, le 18 mars 2024, un plan d’ensemble : Fidélisation 360. Six axes structurants, une stratégie systémique :
- Compenser les sujétions (intégration des primes dans les pensions, nouvelles indemnités),
- Accompagner la mobilité (zéro reste à charge, plateforme de logement Atrium),
- Assurer une rémunération équitable (grilles revalorisées pour militaires et civils),
- Personnaliser les parcours (promotion interne, passerelles vers les filiales industrielles),
- Améliorer les conditions de vie (Plan Famille II, logements, crèches, Wi-Fi, soutien aux conjoints),
- Gagner la bataille des perceptions (communication ciblée, marque employeur, présence renforcée dans les écoles).
Les premiers effets se font sentir : grille indiciaire des sous-officiers revalorisée, indemnitaire civil revu, mobilité croisee facilitée. Mais la mécanique est lente, car les blocages sont profonds.
Une stratégie à plusieurs étages
Au-delà du plan phare, d’autres leviers sont actionnés :
- Recrutement repensé : diversification des contrats, partenariats écoles.
- Politique familiale : 750 M€ prévus jusqu’en 2029 pour accompagner la vie en emprise.
- Réforme des grilles salariales (NPRM) : plus lisibles, plus progressives.
Mais les défis demeurent : viviers asséchés, taux de sélectivité en berne (moins de deux candidats par poste chez les sous-officiers), décrochage des cadres intermédiaires, pression accrue sur les spécialistes du renseignement, du numérique et de l’aéronautique.
Douze recommandations pour une armée durable
Les rapporteurs n’esquivent rien :
- Pérenniser les efforts engagés,
- Décentraliser les politiques de logement,
- Renforcer la gestion prévisionnelle des effectifs,
- Valoriser la reconversion professionnelle comme levier d’attractivité,
- Soutenir les réservistes comme vivier complémentaire,
- Lutter contre les violences sexuelles et sexistes,
- Réduire les freins statutaires à la fidélisation,
- Accroître l’effort sur les filières à haute technicité,
- Mettre en œuvre une véritable politique de mixité,
- Suivre le moral via l’indicateur I2M,
- Soutenir les cadres intermédiaires (notamment les sous-officiers expérimentés),
- Mieux associer les acteurs de terrain à la politique RH.
Car la véritable bataille, aujourd’hui, ne se joue pas seulement sur les théâtres d’opérations extérieures. Elle se joue dans les centres de formation, dans les bureaux RH, dans les cuisines, les hangars, les casernes et les mess. Dans la capacité de l’institution à faire tenir ensemble engagement, reconnaissance et projection.
« L’art de conserver les hommes est le premier des talents militaires. »
Jacques-Antoine-Hippolyte de Guibert
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/cion_def/l17b1152_rapport-information
La désertion
Depuis les phalanges antiques jusqu’aux compagnies modernes, la désertion a toujours hanté les armées. Ce phénomène, loin d’être une nouveauté, est un miroir grossissant des tensions à l’œuvre dans les institutions militaires. De la Grande Armée de Napoléon, dont les campagnes saignaient les bataillons jusqu’à l’os, aux tranchées de 1917 où les mutins de la Marne tournaient le dos à l’ordre aveugle, la désertion a toujours été à la fois symptôme, révélateur et cri de rupture.
Aujourd’hui encore, comme le souligne le rapport d’information n° 1152 présenté par Caroline Colombier et Loïc Kervran, « une augmentation des désertions a été observée, notamment dans l’armée de Terre et l’armée de l’Air et de l’Espace ». Le phénomène est net : 1 418 cas pour l’année 2022 dans l’armée de Terre, contre 893 l’année précédente. « La Marine nationale, en revanche, n’a pas connu d’évolution significative ».
Il serait illusoire de n’y voir qu’une défaillance individuelle. Le rapport insiste sur la diversité des facteurs : choc culturel avec la discipline militaire, mobilité imposée, manque de reconnaissance, conditions de vie parfois rudes. « Chaque cas est traité individuellement, avec une saisine quasi-systématique du procureur », mais la sanction pénale demeure largement théorique : peines avec sursis, classements sans suite. La section AC3 du parquet de Paris « classe systématiquement sans suite » les cas.
La Légion étrangère n’a pas été épargnée. En 2022, 85 légionnaires ukrainiens ont rompu leur engagement pour rejoindre les lignes de front de leur pays. Le geste est politique, existentiel même. Il rappelle, à sa façon, les désaffections de la Guerre d’Espagne ou les exils désobéissants des années 1950 en Indochine.
Dans le contexte contemporain, la désertion n’est plus un tabou, mais un signal. Le rapport note que « les non-renouvellements de contrats à l’initiative du militaire ont augmenté sensiblement depuis 2018 », traduisant un rapport de force inversé. Le choix de partir n’est plus subi, mais revendiqué. Les chiffres sont parlants : 15 000 départs à l’initiative du personnel en 2022.
Le traitement institutionnel s’adapte : avenants réducteurs de contrat, réorientation professionnelle, efforts accrus de communication et de formation de l’encadrement. Mais, reconnaît le rapport, « pour certains militaires, la désertion reste une solution de facilité, avec effet immédiat ». Et souvent, sans conséquence réelle.
La véritable question est peut-être ailleurs. Dans ce que la désertion dit du contrat moral entre la Nation et ses soldats. Un contrat qui ne se résume pas à une solde ni à une prime, mais engage la reconnaissance, le sens donné à l’effort, la justice des choix stratégiques. Quand ces fondements chancellent, les départs se multiplient. Discrets. Inéluctables.
Ce que soulignait déjà Alain dans Mars ou la guerre jugée prend ici toute sa résonance : « Le soldat pensant pense pour l’avenir seulement, pour le ciel, dirait-on presque. » Cette phrase, extraite d’un passage où Alain médite sur la mécanisation de la guerre et l’inertie morale qu’elle impose, éclaire l’abandon progressif de toute forme d’adhésion sincère. La guerre moderne ne tolère plus l’obéissance aveugle, car elle ne promet plus l’héroïsme, mais la mécanisation du sacrifice. Le soldat, devenu rouage dans un dispositif tentaculaire, n’adhère que s’il comprend, que s’il consent, que s’il croit. Sinon, il part. la guerre moderne ne tolère plus l’obéissance aveugle, car elle ne promet plus l’héroïsme, mais la mécanisation du sacrifice. Le soldat, devenu rouage dans un dispositif tentaculaire, n’adhère que s’il comprend, que s’il consent, que s’il croit. Sinon, il part.
Comme l’écrivait Sun Tzu dans L’Art de la guerre :
« Traitez vos soldats comme vos enfants et ils vous suivront jusque dans les vallées les plus profondes ; traitez-les comme vos fils bien-aimés, et ils se tiendront à vos côtés jusqu’à la mort. »
Pascal Tran Huu
administrateur de l’ASAF
02/04/2025



